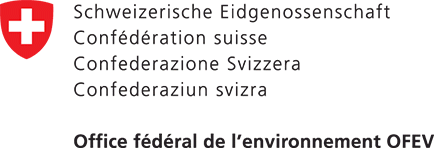Module Libre La ville fait son climat
Adapter l'espace urbain aux fortes chaleurs
Organisation
- Durée: 5 jours (1 jour par semaine)
- Lieu: HEPIA, rue de la Prairie 4, 1202 Genève
- Dates: mardis 21 et 28 avril, 5, 12 et 26 mai 2026
- Coordination: Reto Camponovo
- Coût: CHF 1'500.-*
- ECTS: 2
- Prérequis: Les modules libres ne nécessitent pas de prérequis, mais il est recommandé de posséder une expérience préalable dans le domaine.
Inscription
*(frais d'inscription CHF 200.- / écolage CHF 1300.-)
Objectifs d'apprentissage
La formation vise à répondre aux questions suivantes :
- Comment la structure urbaine amplifie-t-elle la chaleur ressentie par les humains et impacte-t-elle les écosystèmes ?
- Quelles solutions pour limiter l’effet des îlots de chaleur en ville ?
- Comment mobiliser les trames verte, bleue, brune et grise pour qu’elles puissent atténuer au mieux les effets de la surchauffe urbaine ?
- Quels outils et méthodes permettent d’évaluer et d’intégrer les stratégies d’adaptation climatique dans les projets urbains ?
- Quelles pratiques concrètes peuvent être mises en œuvre pour requalifier climatiquement des espaces déjà construits ?
La formation permet aux participant·e·s de :
- Acquérir des connaissances solides sur les phénomènes climatiques urbains et les mécanismes exacerbant la chaleur en ville.
- Comprendre l’influence des trames écologique et bâtie sur le climat urbain et leur contribution aux stratégies d’adaptation.
- Concevoir et intégrer des solutions d’aménagement résilientes favorisant la gestion des sols, de la végétation et de l’eau en ville.
- Analyser les contraintes et les opportunités liées à la transformation des infrastructures existantes afin de limiter leur impact négatif sur le vivant et l’écosystème urbain.
- Bénéficier d’une expertise opérationnelle grâce à des retours d’expérience concrets et des outils applicables dans leurs projets d’aménagement.
Descriptif du cours
Les vagues de chaleur, exacerbées en milieu urbain, représentent l’une des manifestations les plus préoccupantes des changements climatiques en Suisse. Ce phénomène impacte gravement la santé publique, en particulier les populations vulnérables telles que les personnes âgées et les enfants, tout en exerçant une pression croissante sur les infrastructures et les écosystèmes urbains. Avec l’intensification de ces événements climatiques, il est essentiel d’agir sans tarder pour anticiper et réduire les risques, en développant des projets qui intègrent de manière robuste les enjeux climatiques.
Le Laboratoire Environnement, Climat, Énergie et Architecture (LECEA/HEPIA), fort de plus de 15 ans d’expérience en analyse climatique urbaine, a acquis une expertise approfondie dans la mesure des paramètres climatiques. Son approche place l’humain et le végétal au centre de ses recherches appliquées. Grâce à l’utilisation du microclimamètre, un appareil innovant, le LECEA recueille des données précises sur les conditions microclimatiques dans l'espace urbain à l’échelle du vivant. Cette méthodologie permet de mieux comprendre les interactions complexes entre l’environnement urbain, le climat, la santé humaine et les écosystèmes.
Cette formation de cinq jours adopte une approche interdisciplinaire pour analyser les interactions entre infrastructures urbaines, climat, biodiversité et bien-être humain. Elle explore les quatre grandes trames du territoire urbain – brune (sols), verte (végétation), bleue (eau) et grise (bâti) – afin d'identifier les leviers d'adaptation aux fortes chaleurs et d'en dégager les synergies et contraintes.
Alliant apports théoriques, études de cas et retours d'expérience, la formation offre aux participant·e·s des outils et méthodologies pour analyser et mettre en œuvre des solutions adaptées aux défis climatiques urbains. L'accent est mis sur des stratégies opérationnelles quant à la renaturation des espaces, la gestion durable des eaux pluviales, des essences végétales adaptées et la transformation des espaces bâtis pour améliorer la résilience urbaine.
En intégrant ces dimensions dans la planification et la gestion urbaine, les participant·e·s pourront développer des stratégies d'adaptation efficaces conciliant aménagement durable et bien-être des usagères et usagers.
Programme
Sous réserve de modifications
Lors de cette première journée, nous posons les bases nécessaires à la compréhension des microclimats urbains et de leurs interrelations avec l'espace urbain et le vivant.
- Comprendre l'îlot de chaleur urbain
- Définition et observation du phénomène
- Mise en contexte des variations climatiques urbaines
- Les bases physiques et climatiques du phénomène
- Identification des différentes échelles climatiques
- Couches de l'atmosphère concernées
- Processus physiques et microclimatiques en jeu
- La perception humaine de la chaleur en ville
- Physiologie humaine et perception de la chaleur
- Impact des surfaces urbaines sur la température ressentie
- Exemples concrets de mesures réalisées avec le microclimamètre
- Introduction aux trames structurantes de l'environnement urbain
- Définition et rôle des trames grise, verte, brune et bleue
- Effets de ces trames sur l'atténuation ou l'exacerbation de la chaleur en ville
- Présentation des thématiques abordées dans les journées suivantes
Ces connaissances théoriques permettent de mieux comprendre les phénomènes étudiés dans les jours suivants, qui sont consacrés aux solutions d'adaptation et d'aménagement urbain face aux fortes chaleurs.
La deuxième journée porte sur la trame brune, le réseau des sols urbains, essentiels à la végétation, à la biodiversité et à la gestion de l’eau, et qui contribue à atténuer les fortes chaleurs en ville.
- Comprendre la qualité et les fonctions des sols
- Définition et identification des sols urbains
- Contraintes spécifiques aux sols en milieu urbain
- L’Indice de Qualité des Sols (IQS) comme outil opérationnel
- Présentation de l'IQS et de son rôle dans l’aménagement du territoire
- Intégration de la qualité des sols dans une gestion durable des ressources
- Retours d’expériences et solutions pratiques
- Techniques pour "remettre du sol" en milieu urbain : création et recréation de sols (fosses, désasphaltage, technosols, etc.)
- Stratégies de préservation des sols existants
La troisième journée est consacrée à la trame verte, c'est-à-dire le réseau des espaces verts en milieu urbain, en prenant l'arbre comme principal protagoniste.
- Comprendre la physiologie des arbres en milieu urbain
- Fonctionnement du végétal : flux de sève, stomates, interactions avec l’environnement
- Vulnérabilité des arbres face à l'élévation des températures et à l’environnement minéral des villes
- Capacités d'adaptation des arbres aux fortes chaleurs
- Choix et pérennisation des plantations
- Essences adaptées aux conditions urbaines et au climat changeant
- Notion d'indigénat climatique et de résilience des espèces
- Autres formes de végétation et stratégies d’intégration
- Importance des autres types de végétation en ville (ex. lierre en façade végétalisée, couverts végétaux, toitures végétalisées, etc.)
- Retours d'expériences et solutions pratiques
- Liens entre la trame verte, la trame brune et la trame bleue : impact des sols sur la végétation
- Pépinières urbaines et autres initiatives de végétalisation
La quatrième journée se concentre sur la trame bleue, c'est-à-dire à l'eau sous toutes ses formes en milieu urbain.
- L'importance de l'eau face aux vagues de chaleur
- Rôle fondamental de l'eau pour les sols, la végétation et le bien-être humain
- Le cycle de l'eau et les risques de sécheresse en Suisse
- Repenser la gestion de l'eau en ville
- Gestion des extrêmes : stockage des eaux pluviales et réutilisation
- L'approche de la "ville éponge" et ses applications dans certains cantons.
- Aménagements urbains intégrant l'eau
- Différentes formes d'eau en ville : fontaines, bassins, jets d'eau, brumisateurs, étangs, rivières et lacs
- Impact sur le rafraîchissement et le ressenti thermique de l’être humain en milieu urbain
La dernière journée est consacrée à la trame grise, c'est-à-dire l’ensemble des infrastructures bâties qui constituent la ville.
- Effets de l’infrastructure urbaine sur la chaleur
- Influence des bâtiments et des revêtements urbains sur l'îlot de chaleur
- Concepts de base pour améliorer le confort thermique urbain
- Leviers d’action pour une requalification climatique
- Comment laisser plus de place aux écosystèmes en milieu urbain ?
- Freins et opportunités pour l'intégration des trames verte, bleue et brune
- Retours d’expériences et témoignages
- Présentation de cas concrets par des professionnel·le·s de l’aménagement.
- Défis et solutions pour intégrer la problématique climatique dans les projets urbains
Cette journée met en lumière les défis et stratégies d’adaptation du bâti existant afin de rendre la ville plus résiliente aux vagues de chaleur et plus habitable.
Public cible
Cette formation s’adresse principalement aux professionnel·le·s et aux actrices et acteurs de l’aménagement du territoire, directement impliqué·e·s dans la planification et la transformation des espaces urbains:
- Urbanistes, architectes et ingénieur·e·s
- Responsables et technicien·ne·s des collectivités publiques
- Paysagistes et gestionnaires d’espaces verts
- Autorités politiques
- Chercheuses et chercheurs
- Etudiant·e·s avancé·e·s
Intervenant·e·s
La liste définitive sera communiquée prochainement.
En totalité: jusqu'à 30 jours avant le début du cours.
- 50% du montant: entre 30 jours avant et le début du cours.
- Aucun remboursement: dès le début du cours.
- Les demandes de report ou d’annulation doivent être formulées par lettre recommandée.
- Les données sont traitées de manière strictement confidentielle dans le respect de la législation applicable en matière de protection des données.
- Les dossiers incomplets ne sont pas traités.
HEPIA se réserve le droit de ne pas ouvrir un cours si le nombre d'inscrit·e·s est insuffisant. Si tel devait être le cas, la décision sera communiquée 15 jours avant le début du cours.
Les modules libres ne nécessitent pas de prérequis, mais il est recommandé de posséder une expérience préalable dans le domaine.
Les personnes qui suivent un cours reçoivent une attestation de suivi d’études et obtiennent 2 crédits ECTS en cas de validation de l’examen final.